Producteur, réalisateur, césarisé, Nicolas Guiot est membre du jury de la nouvelle-née Next Generation, une compétition du BSSF consacrée aux films d’école. Après avoir répondu à mon questionnaire machiavélique, nous nous sommes livrés à une interview fleuve. Rencontre avec un homme de cinéma intelligent, comique, et qui paie sa tournée.
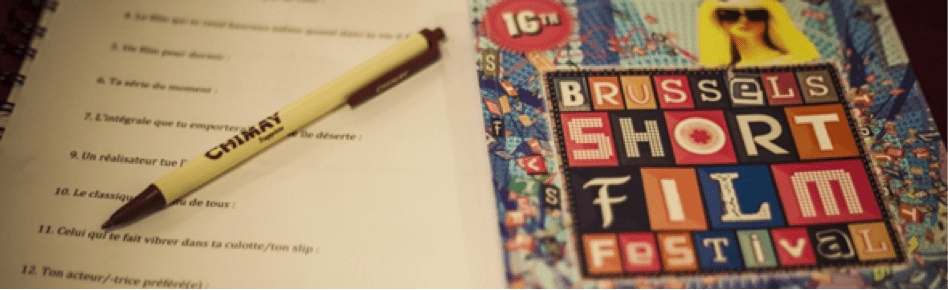
Tu
es qui ?
Quelqu’un qui travaille dans le cinéma depuis quelque temps.
J’essaie d’en faire à mon petit niveau
Tu as fait la philo et puis Elicit.
Je voulais faire l’INSAS, où je n’ai pas été accepté. La philosophie pour moi, c’était pas des études que je faisais dans un but professionnel, je le faisais pour moi, parce que ça m’intéressait mais mon but final, c’était le cinéma.
Elicit, sur le coup, c’était un peu par dépit parce que j’avais raté l’INSAS. Avec le recul, je me rends compte que ça m’a apporté beaucoup de choses, notamment les rencontres : la plupart de mes associés aujourd’hui sont des gens que j’ai rencontrés là-bas. J’ai rencontré aussi Luc Dardenne — qui était mon directeur de mémoire — puis j’ai bossé sur L’enfant comme stagiaire régie. Je pense aussi qu’on a eu une formation au scénario assez poussée, même si sur le coup, j’avoue que je ne m’en rendais pas trop compte.

C’est quoi, Ultime razzia ?
Ultime razzia, c’est une petite boîte de production qu’on a fondée avec quatre amis pour, au départ, produire nos propres films. Finalement, on s’est ouverts petit à petit aux autres réalisateurs et il se trouve que ça a plutôt bien marché. Donc, c’est la boîte par laquelle je me suis retrouvé producteur par accident.
Pourquoi Le cri du homard s’appelle comme ça ?
C’est parti d’un brainstorming à la con. C’est une référence au docu, sur lequel j’étais tombé par hasard, sur ces jeunes gars qui revenaient de la guerre. Ils étaient tout jeunes, dix-huit, dix-neuf ans et ils étaient absolument détruits et absolument abandonnés du pouvoir.
Après, la thématique qui m’intéresse plus profondément, c’est l’impossibilité d’exprimer certaines choses après avoir vécu un trauma. C’était déjà une des thématiques de mon mémoire de philo, qui traitait du silence. C’est une thématique qui, finalement, m’a poursuivi.
Un tournage en France sur un russe qui revient de Tchétchénie. En fait, tu détestes la Belgique ?
Voilà. Absolument. Je déteste la Belgique! [rires] On a eu de l’argent de la Région Centre en France, ce qui implique qu’on doive tourner là-bas. Pour mon scénario, ce n’était pas un problème : j’avais de toutes façons imaginé de le tourner en Belgique ou en France. Ce qui était un artifice de scénario au départ pour ne pas devoir aller tourner en Russie, je l’ai utilisé pour appuyer le sentiment d’étrangeté du personnage principal : quand il revient, c’est dans un pays dont il ne comprend pas la langue, qu’il ne comprend pas.

Ça
ne fait pas un peu peur pour la suite, autant de succès dès ton premier film ?
J’essaie de ne pas avoir peur. Je suis très conscient que c’est à double
tranchant, qu’on m’attend au tournant, qu’on ne me fera pas de cadeau. Mais je
ne veux pas me précipiter. Je veux prendre mon temps, prendre du recul, pas
faire un film pour faire un film. Donc, voilà, on verra. Puis pour moi, il y a
trop de films. Je ne parle pas des films ratés, je ne parle pas de mauvais
films : je trouve qu’il y a plein de films qui ne devraient pas exister.
Il
y a trop de films. Même les tiens ?
Pourquoi pas. Souvent, je me dis que le scénariste ou le réalisateur n’avait
rien à dire dès le départ et aurait pu tout à fait se passer de faire ce film.
Je n’ai pas envie de tomber là-dedans. Ce qui ne m’empêchera pas de rater un
film, comme tout le monde, quoi. C’est très facilement ratable, un film.
Tu
as envie de passer au long ou le court te plaît ?
Je prendrai le format qui correspond à l’histoire que j’ai envie de raconter.
Chaque scénario a sa réalisation propre ; je pourrais très bien faire un film
tout à fait différent du premier. Idéalement, si je pouvais faire une
magnifique comédie noire, je serais très heureux mais je ne suis pas sûr d’en
être capable.
Le festival du court-métrage, c’est quoi, pour toi ?
C’est un festival que je fréquente depuis que je suis arrivé à Bruxelles. C’est devenu des amis. Je fais partie du comité de sélection de la compétition internationale depuis cinq ans, je crois. C’est aussi le festival de court le plus important en Belgique. C’est beaucoup de fêtes, beaucoup de monde.
Le
premier où Le cri du homard a
eu un prix, aussi.
C’est mon tout premier festival : c’est la première fois qu’on le montrait au
public — ce qui est très très angoissant — et c’est mon premier prix,
oui.

Le
court métrage, qu’est-ce que c’est, pour toi ?
C’est toujours la question : « Est-ce que c’est un art en soi ? » Je pense que
pour certains, oui. Il y a beaucoup de films qui ne peuvent se décliner qu’en
courts métrages. Il y a une vraie création typiquement court métrage. Il y en a
d’ailleurs qui se cantonnent aux courts métrages toute leur vie,
volontairement. Et puis, c’est considéré par beaucoup comme un premier pas vers
le long. Donc, je pense que ça peut être les deux.
Je pense qu’on voit des courts métrages aujourd’hui, globalement, qui sont de
qualité bien meilleure que bien des longs qu’on peut voir en salle. On est bien
loin des petits films qu’on voyait il y a dix, quinze ans où il suffisait d’une
bonne idée pour pouvoir cartonner partout. Il y a des petites perles qui sortent
de nulle part. Il faut les dénicher.
Tu es ici juré pour la sélection Next Generation. Ça t’éclate ?
Oui. C’est drôle de juger des films d’écoles alors que je n’en ai pas faite. Plus sérieusement, c’est très grisant de pouvoir peut-être mettre en avant des réalisateurs ou des films qui nous ont touchés, auxquels on tient. Je sais à quel point c’est important, je mesure tout à fait le poids que peut avoir un prix.
Qu’est-ce
que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans le cinéma ?
J’ai eu tellement de conseils que je n’ai pas suivis… Ce qui est sûr, c’est que
les choses ne sont pas faciles, n’arrivent pas rapidement. Donc, si on y croit,
il faut s’acharner. Et pas forcément écouter les conseils des autres. Ou bien
choisir ses conseillers.

T’en
penses quoi, de la situation du cinéma en Belgique ?
Le cinéma belge a une très très bonne réputation à l’étranger, ça c’est sûr. Ce
n’était pas le cas il y a vingt ans. Il y a vraiment une grosse production et
la qualité est très bonne, proportionnellement à la taille du pays. C’est assez impressionnant, en fait.
Tu as le « statut » ?
Mon « statut d’artiste », moi, je ne l’ai jamais eu. Enfin, le « statut d’artiste », ce n’est jamais que le statut de bûcheron auquel les artistes ont droit. Il n’y a pas de statut d’artiste aujourd’hui. Je crois que c’était la dernière des priorités pour le politique, déjà à l’époque, et maintenant, encore moins. Et je pense que ça ne va pas s’arranger.
T’arrives
à en bouffer ?
Je suis salarié de ma boîte depuis neuf mois. Mais ça fait neuf mois ; pendant
dix ans, j’avais les700€ par mois qu’on a
gracieusement après nos études. Sinon, je bossais sur des
courts parfois à 20€ la journée, parfois sur des longs mieux payés, ce qui me
permettait un peu de bouffer. Voilà, ça a été la débrouille pendant dix ans.
C’est toujours un peu la débrouille, mais c’est un peu plus facile pour le
moment. Ça ne durera sans doute pas éternellement. [rire jaune]

Qu’est-ce
qui te fait bander dans le cinéma ?
Les films auxquels je repense des semaines après, ça, ça me fait bander.
Qu’est-ce
qui te fait bader dans le cinéma ?
Ce qui me fait bader dans le cinéma, c’est terrible à dire, mais c’est le
public. Je suis conscient du côté industriel du cinéma, ça doit marcher, c’est
un spectacle. Mais ce n’est pas parce qu’on veut toucher un grand public qu’on
doit faire de la merde et prendre les gens pour des cons. Et je suis affligé
que les gens acceptent d’être pris pour des cons. Il y a des tout grands films
grands public de divertissement mais parfois, on se fout vraiment de leur
gueule.
Un film intelligent grand public, c’est le Graal ?
Absolument. Pour moi, c’est l’essentiel. Il y a des comédies qui ont touché un large public que je trouve formidables. Je pense, comme ça, au Goût des autres de Jaoui et Bacri : c’est remarquablement écrit et ça a cartonné. Des films comme ça, ça me fait du bien. Quand j’ai découvert Bienvenue chez les ch’tis, je partais vraiment avec un bon sentiment en me disant « ça va être sympathique ». Je suis tombé des nues de ce côté médiocre à tous les niveaux. Ça m’a vraiment affligé, ça m’a fait de la peine…
Quand j’écris un film, je pense tout le temps au spectateur : je n’ai pas envie d’emmerder les gens. Moi, ce que je voudrais faire, ça c’est vraiment le Graal, c’est C’est arrivé près de chez vous, je sais que c’est tarte à la crème, tout le monde le dit, mais j’adore vraiment ce film. Ou les films Delépine/Kervern. Le film que j’ai fait en est très loin mais je suis un fan absolu. Je les ai vu tous, même Avida qui n’a pas été distribué en Belgique, je l’ai vu à la Cinematek.
Un plaisir cinématographique honteux ?
J’hésite entre Rabbi Jacob — la danse de Rabbi Jacob — et les films de Nicolas Monfort.
Photos : Gautier Houba